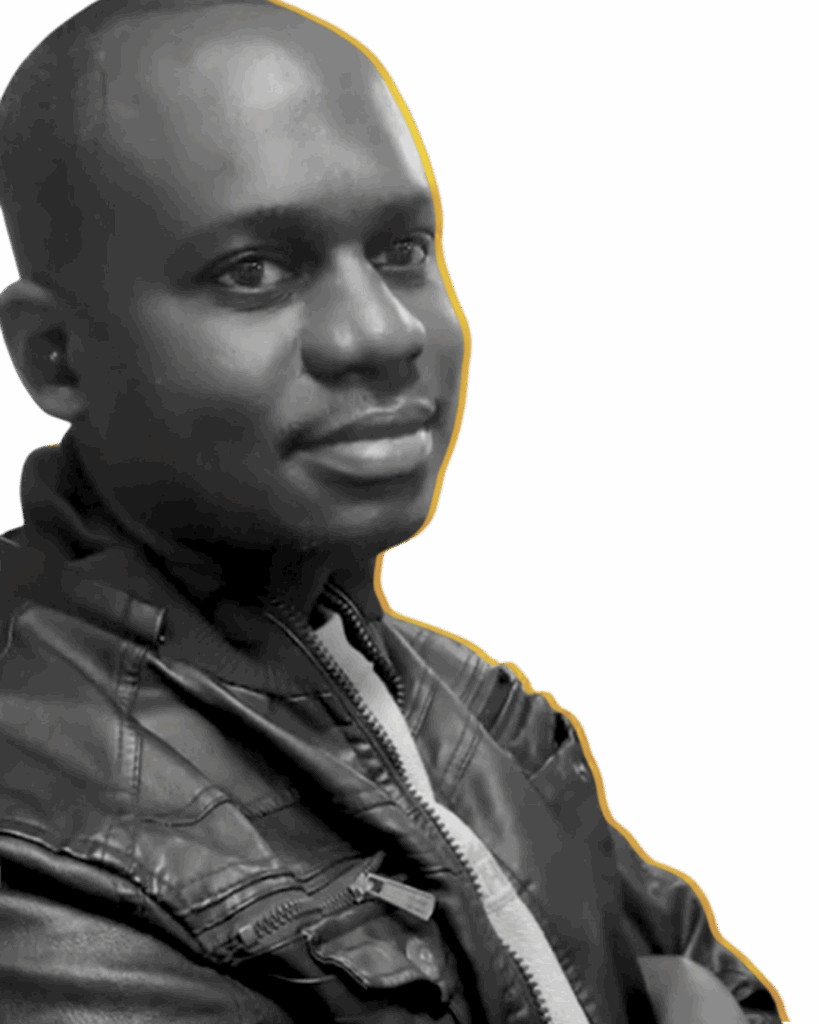Commençons par un constat : au cœur de telle rue ou de telle place, surgissent parfois des cris de manifestants. Ils indiquent une colère ou une indignation et appellent à les rejoindre. Écoutez bien les sons qui vous arrivent. Vous réussissez très vite à les distinguer de ces hurlements particuliers, râles de quelques-uns et appels divers qui meublent aussi la rue au quotidien. Ce sont des cris spécifiques. Deux choses y sont importantes : la hauteur et le rythme des sons, et la forme sensible d’une manifestation que des slogans explicitent. Ces cris, politiques, en foule, constituent une pensée en porte-voix. Ils gardent peu de choses de la voix individuelle ordinaire, et encore moins de la voix des chanteurs. Ils se font multitude. Ils rassemblent sans préséances inutiles les un(e)s et les autres afin de lier une force dans la rue à la légitimation d’une préoccupation.
Ceci constaté, il est judicieux de se demander si crier ainsi fait vraiment office de contribution à la vie politique démocratique. Un cri, n’est-ce pas uniquement une espèce de fureur passagère, tout juste bonne à susciter une curiosité momentanée ou un effroi ? Si les manifestants, en marche ou en sit-in sont persuadés qu’avec leurs cris ils vont soulever le vide d’une cité figée, ne se trompent-ils pas ? Si effectivement ils ne suivent pas la voie des habitudes politiques canalisées par des règles et donnent en marchant forme à une puissance dans la rue, participent-ils vraiment de la vie d’une cité qui se veut démocratique, c’est-à-dire, pour une part, à une vie de délibérations impliquant un art de l’argumentation ? Effectivement, le cri n’appartient pas directement à ce registre.
Le cri d’un manifestant n’est pas une nuisance : il est la traduction sensible d’un tort.
Lançons-nous alors dans une série de questions concernant ces cris d’indignation et de dissentiment. Parmi les considérations venant à l’esprit, il y a d’abord une difficulté. Le mot « cri » peut désigner toutes sortes d’expressions : un son, une réaction, un acte de langage, une image, une dramaturgie esthétique, une métaphore, parfois des lieux (une place) ou des temps (des périodes de grève) selon les sociologues qui le cantonnent par exemple trop vite à « la banlieue » ou aux Gilets Jaunes (et leur cri « ahou » lancé à la manière des Spartiates). Que signifie « cri » dans le cas qui nous préoccupe ici ?
Un détour par le dictionnaire s’impose. Il souligne une curiosité. Le terme « cri » provient du verbe crier, du latin criare : dire d’une voix retentissante, crier au secours, protester. Cette étymologie est assortie d’une remarque, qui résulte d’un propos très ancien. C’est à Rome que cela se passe. Dans ses discours, l’écrivain romain Varron dérive « cri » de quiris, citoyen. « Cri » dirait alors : « convoquer les citoyens ».
Voilà qui nous concerne directement.
La vie publique
Sortons de l’histoire romaine, reportons la leçon de Varron à nos conditions politiques modernes, démocratiques, et aux notions qui lui servent de support : dèmos (peuple), voix, loi, droit, État de droit, espace public. Autant de notions sujettes à définitions, discussions, histoire, mais aussi à éducation politique. Curieusement, la notion de cri n’est pas contenue dans cette liste ! Elle serait plutôt opposée à « voix » et/ou à « parole ».
Et pourtant, il a fallu crier, donc donner de la voix, parler fort pour « avoir » la démocratie (historiquement). Il faut crier (à présent) pour « avoir » des lois justes, pour obtenir des réformes ou se plaindre de mauvais traitements ou faire valoir des futurs. Devant les réductions des crédits de la culture, devant les inégalités qui s’approfondissent, devant les censures d’œuvres ou de propos politiques, acceptons-nous pas d’être empêchés de prendre des positions que les cris signifient en public, de creuser des écarts dans l’usage des voix et de muer les cris en actes destinés à faire bouger les places attribuées, notamment dans des délibérations publiques. Demander, et n’obtenir qu’en importunant par des cris, conduit bien à des résultats. Même si parfois cela expose à des répressions sévères. Preuve que la société, comme la politique démocratique, est divisée par des rapports de force. Du point de vue démocratique justement, un véritable jeu d’opposition et un enjeu se dessinent là.
Autour du cri se partagent des appréciations et des considérations politiques qui ont une incidence sur l’effectuation de la démocratie, ainsi que le souligne Aristote. Cette manifestation sensible des citoyennes et citoyens est combattue par ceux qui réduisent la politique au charme discret de la conversation réputée pacifique, et le cri public au désagrément inaudible d’une sécession. Elle l’est aussi plus insidieusement par ceux qui considèrent que les cris de leur parti en foule défilante sont en soi légitimes parce qu’elles constituent une forme de délibération du « peuple » dans la rue, les cris des « autres » étant évidemment illégitimes et nuisibles ! Enfin, plus généralement, l’idée que le cri pourrait passer pour une notion centrale dans une théorie de la démocratie produit un sentiment négatif. Le terme ne recouvrirait que des perspectives désastreuses, des hurlements incompréhensibles, une absence de paroles communes réelles et possibles.
Crier, ce n’est pas rejeter le débat : c’est réclamer d’y être inclus.
Du point de vue de l’enjeu, il est possible de reconsidérer entièrement cette « nuisance » sonore, phonique (dans la rue) ou écrite (sur des affiches, dans des tracts ou des libelles). S’il n’est pas question d’ennoblir inutilement le terme, il reste central de faire entendre dans le « cri », manifesté ou théorisé, une pensée en acte, une puissance politique positive liée à la fois à une conception de la société comme communauté fracturée, à une conception de la justice à rectifier et à la nécessité d’une réinvention permanente de la démocratie.
Les philosophes démocrates n’ont pas exclu le cri des affaires publiques ou de la politique. Le cri, constatent-ils, a bien trait non seulement à des mouvements dans les lieux et l’espace publics mais encore au devenir d’une démocratie qui ne saurait être donnée une fois pour toutes, au peuple qui ne relève d’aucune identité figée, à la loi, au droit et à l’État de droit. S’il reste l’objet d’une curiosité critique de la philosophie pour la politique, c’est parce qu’il se pourrait que l’instauration de la politique tienne justement à des cris. Bien que se livrent aussi des références différentes aux cris, puisqu’on tente parfois de le ou les masquer ou de le ou les mépriser afin de détourner l’idée même d’action politique. Signant une forme d’intervention publique (sonore, imagée ou théorique comme le sont les « écrits-cris »), même s’il faut distinguer le cri de la rue, le cri dans la rue, le cri des « gens » de la rue, ou le cri des « gens » dans la rue, les cris d’indignation et de dissentiment lancent la révolte, orientent et polarisent, incitent à argumenter sur tel point afin de le rendre litigieux. Ils se multiplient dans l’effervescence ou l’enthousiasme, et demeurent pleinement politiques.
Un devenir démocratie infini
À examiner de près les manières de caractériser la voix humaine dans le registre de la « communication » politique ou du paysage sonore public, on ne peut pas rester insensible à l’identification méprisante, par certains, des cris humains à des registres animaux (bêlement, braiement…), voire à l’animalité ainsi que l’accomplit le philosophe Alain en 1927, et par d’autres à de simples clameurs insignifiantes. La gamme des interprétations négatives des cris humains dans la rue est bien elle-aussi un objet politique. Elle refuse aux cris le statut de proclamation. Elle se contente de fustiger le cri, il ne serait qu’un bruit qu’aucune oreille ne saurait retenir ou prendre au sérieux.
La question du cri, en démocratie, se trouve ainsi prise au cœur d’une mésentente et d’un jeu d’opposition non seulement avec les notions de débat, de délibération, mais encore avec les notions de clameur, de murmure ou de rumeur. Les leçons morales actuellement diffusées contre ladite « culture du clash » par fait de brutalisation de la vie publique ou un climat social délétère par absence, dit-on, de véritable dialogue, sont orientées par cette mésentente, réduite à la condamnation du cri dogmatique péremptoire qui ne donnerait même pas ses raisons et du cri incapable de donner forme à une réflexion. Ces leçons constituent une sorte de victoire du principe du « communicable » – valorisant les démocraties libérales établies du consensus, au sens des travaux du philosophe Jürgen Habermas – sur le désaccord ouvrant sur un devenir. Du moins, si le premier est identifié à l’énoncé d’arguments clairement formulés (comme si la table des débats était toujours stable !), et le second à des vociférations brutales.
Or, la vie démocratique doit être pensée aussi à partir du statut prêté au cri ou aux cris. Non seulement il apparaît vite que cri et consensus, par exemple, s’opposent surtout sur la manière de concevoir la démocratie, mais encore sur la fin de la démocratie qui coïnciderait avec l’effacement du cri et de son cri originaire (les révolutions), comme en un idéal à viser, pourtant toujours reporté dans les faits.
Autrement dit, concernant le cri, de quelles actions y a-t-il cris ? Comment distinguer vociférations, brouhaha et cri ? Entre quels membres du corps social cela a-t-il lieu ? Comment penser le rapport démocratie et cri, ou plutôt devenir dèmos par le cri ? Une telle réflexion provoque évidemment un embarras parce que l’enjeu n’est pas qu’on s’entende bien ou mal, comme on le dit souvent, au droit de la forme des débats politiques. Les propos échangés autour du cri et de son usage ne sont pas seulement équivoques. L’enjeu n’est pas non plus que les mots aient enfin un sens bien défini… ou qu’on apprenne définitivement ce que les mots veulent dire !
Pour prendre de la hauteur avec notre époque, pensons au cri d’indignation sociale (« Quoi ! Toujours laquais ! », s’exclame Jean-Jacques Rousseau à propos de collègues en service), au cri du manifestant méprisé par les autorités (« démission ! » à propos d’un ministre, d’un président), au cri des peuples opprimés ou gommés (« rendez-nous nos terres ! »), au titre du journal de Jules Vallès (Le Cri du Peuple), d’une collection « Tracts » chez un éditeur, aux cris historiques qui vident une situation pour en forger une autre : « À bas le roi ! Vive la nation ! » (Honoré-Gabriel Mirabeau), « Mourir plutôt qu’être asservi ! » (l’esclave), mais aussi aux affiches-cri, ainsi qu’aux écrits-cris (cf. notre article dans la revue L’Étrangère, « Le cri-écrit : potentiel protestataire des intellectuels ? Minima Moralia, Theodor W. Adorno », 2018).
D’une manière ou d’une autre, ces cris d’insoumission, de soulèvement, de dissidence, de désobéissance, d’inconduite ou de « contre-conduite » (comme le souligne le philosophe Michel Foucault, le 11-12 mai 1979, dans un texte republié dans Dits et écrits, III) se rapportent à la question de la justice et de la politique. Sur ces deux plans, la question à élaborer est celle de savoir moins comment les cris sont émis, que par qui, à partir de quel tort, et comment les cris sont-ils entendus par ceux auxquels ils s’adressent, s’ils le sont. Elle est aussi de savoir dans quelle mesure leur compréhension permet de forger une théorie de la pratique politique ou de l’histoire à faire.