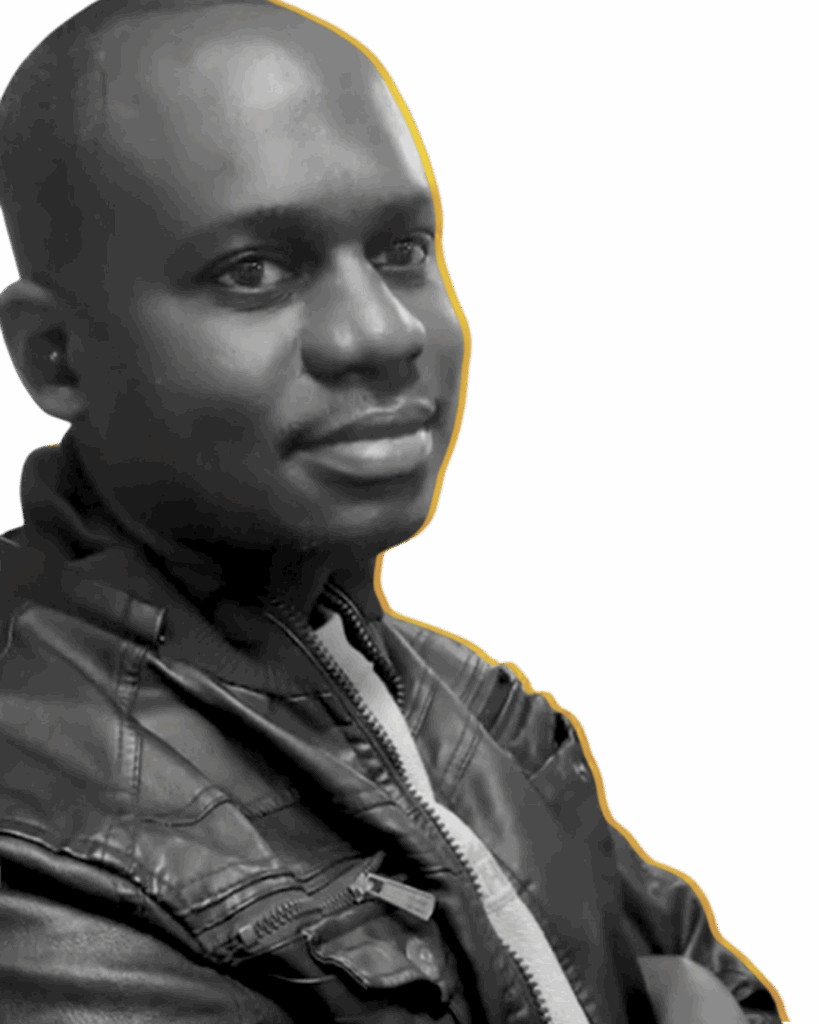Comment comprendre l’évolution politique de certains de ces acteurs, longtemps associés au progressisme démocrate, vers des orientations conservatrices et populistes ?
Nous avons tendance à faire une lecture quelque peu monolithique de la droitisation de la Silicon Valley, parce que des années 1960 à la fin des années 2010, les milieux intellectuels de ce groupe d’entreprises tech étaient plutôt associés à un progressisme. Cette vision mérite d’être un peu nuancée.
L’universitaire américain Fred Turner a montré que la Silicon Valley avait exprimé un idéal utopique progressiste lié à la cybernétique. Cet idéal était associé à la contre-culture des années 1960-70, remettant en cause la souveraineté étatique d’une administration centrale. Ce contexte est aussi lié au développement du libertarianisme, qui reçoit aussi bien des interprétations de droite que de gauche.
Comment cet écosystème idéologique a-t-il évolué jusqu’à aujourd’hui ?
Dans les années 2010, on a ensuite observé le tournant droitier de certains entrepreneurs de la tech, en deux vagues. D’abord, les premiers soutiens du trumpisme, avec Peter Thiel comme chef de file, un milliardaire s’engouffrant dans la brèche Trump. Thiel était conservateur depuis longtemps, ayant vivement critiqué l’« affirmative action » et les politiques de diversité à l’université dans les années 1990. La seconde vague, représentée par Marc Andreessen, Mark Zuckerberg ou Sam Altman par exemple, est plus ambigüe, notamment parce qu’ils semblent avoir soutenu Trump par opportunisme. Il faut cependant relativiser cette droitisation parce que la majeure partie des ingénieurs et des milieux de la tech ne s’y sont pas nécessairement associés.
Un philosophe, Nick Land, semble être à la racine des mouvements portés par les Lumières noires. Dans quelle mesure la pensée de ce philosophe est-elle primordiale pour comprendre la récente révolution des idéaux de certains puissants ?
Les « Lumières sombres », ou Dark Enlightenment, est un courant intellectuel né à la fin des années 2000 et promu par certains entrepreneurs de la tech, en particulier Peter Thiel et Marc Andreessen, afin de structurer idéologiquement ce qu’on appelle la tech right, c’est-à-dire la droite technologique. Dans les faits, ce courant n’est pas seulement une constellation intellectuelle mais aussi un instrument idéologique visant la dérégulation de l’innovation technologique aux États-Unis.
Sur le plan théorique, ce courant s’enracine principalement dans les écrits de Curtis Yarvin, ingénieur informatique connu sous le pseudonyme de Mencius Moldbug, et ceux de Nick Land en effet, dont la trajectoire intellectuelle est très particulière. Leur idéologie fondée sur le changement de régime – c’est-à-dire la fin de la démocratie – est ce qu’on appelle aujourd’hui la pensée néo-réactionnaire. Il existe évidemment des divergences au sein de ce courant. Si Curtis Yarvin demeure focalisé sur un changement de régime efficace, Land introduit la dimension proprement technologique et capitaliste libérée de toute entrave de développement.
Ces milliardaires auraient donc utilisé ces pensées pour promouvoir leur nouveau modèle de civilisation ?
En effet. Peter Thiel, en particulier, s’est emparé de cette contre-culture naissante et l’a élevée au rang d’outil politique, jouant un rôle de courroie de transmission entre ce milieu internet culturel marginal ignoré des cercles de pouvoir et les sphères politiques américaines. Thiel a non seulement financé la start-up de Yarvin, lui permettant de poursuivre ses activités idéologiques, mais a aussi soutenu des figures politiques devenues aujourd’hui influentes telles que J.D. Vance, dont il a accompagné l’ascension professionnelle puis la carrière politique, Michael Anton, plus tard conseiller à la Maison-Blanche, ou encore Blake Masters, candidat au Sénat.
Cette dynamique se retrouve-t-elle aujourd’hui dans la nouvelle idéologie du pouvoir ?
En tout cas, certains entrepreneurs y trouvent un intérêt stratégique. En s’appuyant sur cette contre-culture, Peter Thiel a cherché à infléchir le trumpisme en faveur de la tech. La néoréaction, issue des réflexions de Yarvin et de Land, s’avère à la fois antidémocratique et techno-accélérationniste : l’État ne doit plus intervenir pour limiter moralement ou fiscalement l’activité économique et technologique mais libérer des contraintes institutionnelles, l’innovation et le capital, ce que Nick Land conceptualise en un impératif civilisationnel : relâcher les freins de la modernité pour accélérer son propre dépassement.
Le trumpisme des origines, notamment lors de la campagne de 2016, portait un discours national-populiste, méfiant envers les élites économiques et les géants technologiques. En introduisant les thèses néoréactionnaires dans cet univers, la droite tech essaie d’infléchir le trumpisme, conciliant autorité politique et liberté d’innovation. C’est d’ailleurs ce que l’on observe aujourd’hui : la campagne victorieuse de 2024 s’est appuyée sur un programme de dérégulation, pro-tech, et de promotion de l’intelligence artificielle américaine.
L’objectif du contrôle des masses
Certains projets portés par ces entreprises peuvent sembler clairement dystopiques, comme celui de Larry Ellison avec Oracle qui prévoit de doter chaque individu d’une caméra 24h/24 pour assurer la sécurité et la data.
Ces projets de surveillance intégrale relèvent-ils vraiment d’une stratégie politique assumée ?
Oracle est un bon exemple. On pourrait également évoquer Palantir, l’entreprise fondée par Thiel, qui joue elle aussi un rôle majeur dans la mise en place d’une forme de surveillance généralisée, utilisée à la fois dans des contextes de politique étrangère et plus discrètement, dans le cadre de la surveillance intérieure.
Oracle et Palantir illustrent parfaitement les tensions et contradictions internes de cette galaxie. Si l’on se réfère à la production idéologique néoréactionnaire, et en particulier à celle de Peter Thiel, il ne s’agit pas d’un projet centralisateur ou dystopique, bien au contraire. Thiel s’oppose explicitement à l’idée d’un gouvernement technologique globalisé et de type panoptique. Dans plusieurs de ses textes, il décrit le scénario d’un capitalisme de surveillance mondialisé comme une figure de l’« Antéchrist », reprenant ici un vocabulaire chrétien, pour en faire l’incarnation de ce qu’il faut précisément éviter.
Un tel discours n’est-il pas contradictoire avec ce type de pouvoir centralisé ?
Pour comprendre cet apparent paradoxe, il faut revenir à la matrice libertarienne de ces entrepreneurs, reposant sur l’idée que la multiplication des initiatives privées constitue en soi, une garantie contre la centralisation du pouvoir. Autrement dit, dans leur logique, une pluralité d’acteurs privés opérant dans la sécurité et la surveillance empêcherait l’émergence d’un monopole étatique et préserverait certaines libertés individuelles par la concurrence.
Ce discours alambiqué a vocation à se protéger des accusations, pourtant légitimes, de collusion avec l’État. Car dans les faits, ces entreprises entretiennent bel et bien des partenariats étroits avec les appareils publics, notamment dans les domaines militaires et sécuritaires.
Cette inspiration autoritaire que revendiquent certains acteurs de la Silicon Valley, peut-elle réellement trouver une traduction politique dans l'Amérique actuelle à la suite des récentes manifestations « No Kings » ?
Ces rassemblements font directement techno-monarchisme prôné par Curtis Yarvin. Contrairement à Nick Land, Yarvin se concentre davantage sur la théorie politique et la refondation des institutions. Sa thèse principale est que la démocratie est structurellement inefficace : elle ne garantit ni la prospérité, ni la sécurité, ni la souveraineté. Il propose donc de la remplacer par un système politique plus stable, fondé sur une organisation « rationnelle » et hiérarchisée de l’État.
Dans cette logique, Yarvin invite à considérer l’État non plus comme une entité politique fondée sur un contrat social, mais comme une entreprise géante dont la mission serait de garantir la prospérité et la sécurité d’un territoire. Or, selon lui, les entreprises les plus performantes du monde fonctionnent selon un modèle clair : un PDG investi de larges pouvoirs, responsable devant un conseil d’administration. Le techno-monarchisme repose donc sur un monarque-PDG, dirigeant l’État selon des critères d’efficacité et de rendement, ce qui implique la suppression des droits démocratiques, de l’État de droit.
Avez-vous des éléments concrets qui illustrent ce projet idéologique ?
Oui, par exemple la création du Department of Government Efficiency (DOGE), confié à Elon Musk, qui, bien qu’incapable d’accéder à la présidence pour des raisons constitutionnelles, incarne précisément la figure du chef-entrepreneur chargé de « rationaliser » l’État. Plus précisément, il représente la figure du « liquidateur » dans la théorie de Curtis Yarvin. L’idée est de réduire massivement les dépenses publiques, de liquider des pans entiers de l’administration pour la « restructurer ».
S’il est excessif de parler d’une transformation officielle des États-Unis en monarchie technologique, les signes d’une transition vers un autre type de régime fondé sur des principes d’efficacité entrepreneuriale, sont bien présents.
La réponse de la démocratie
Face à cela, quelle stratégie les démocraties attachées à l'État de droit peuvent-elles développer ?
Il faut d’abord reconnaître un fait essentiel : nous ne sommes plus simplement face à une résurgence du national-populisme tel qu’on l’a connu dans les années 2010, avec cette rhétorique opposant les masses aux élites dans le but de conquérir le pouvoir à travers un discours identitaire ou souverainiste.
La mouvance néoréactionnaire et ses relais dans la droite tech, ne visent pas à séduire les masses, mais à convertir les élites politiques à un autre modèle de gouvernement. Ce projet a aujourd’hui une influence politique réelle : aux États-Unis bien sûr, mais aussi en Argentine et progressivement en Europe, où commencent à émerger des cercles néoréactionnaires encore confidentiels mais déjà présents.
Pour les démocraties, la première étape est de prendre acte de cette transformation idéologique, que ces idées circulent désormais dans les sphères du pouvoir.
Et comment un individu informé peut-il lutter à son échelle pour son idéal de liberté ?
Je pense que la simple défense de la supériorité morale de la démocratie est peu efficace. Il faut redémontrer que ce régime est efficace et performant pour garantir la prospérité et le bien-être collectif. Les données empiriques sont d’ailleurs claires : le niveau de satisfaction, de qualité de vie ou de bien-être dans les régimes démocratiques reste, en moyenne, supérieur à celui observé dans les régimes autoritaires.
Il faut aussi comprendre que l’un des grands moteurs de la pensée néoréactionnaire repose sur la comparaison avec la Chine. La rhétorique est simple : la Chine n’est pas démocratique, et elle est plus efficace. Pour affronter une telle puissance, les démocraties devraient opérer une mutation politique, pour éviter tout déclin géopolitique. Si l’on veut contrer ce discours, il faut donc construire un récit alternatif, montrer que le régime démocratique n’est pas fragile dans la compétition mondiale, et qu’il représente au contraire, la condition d’une puissance durable, fondée sur la liberté et l’adhésion des citoyens.