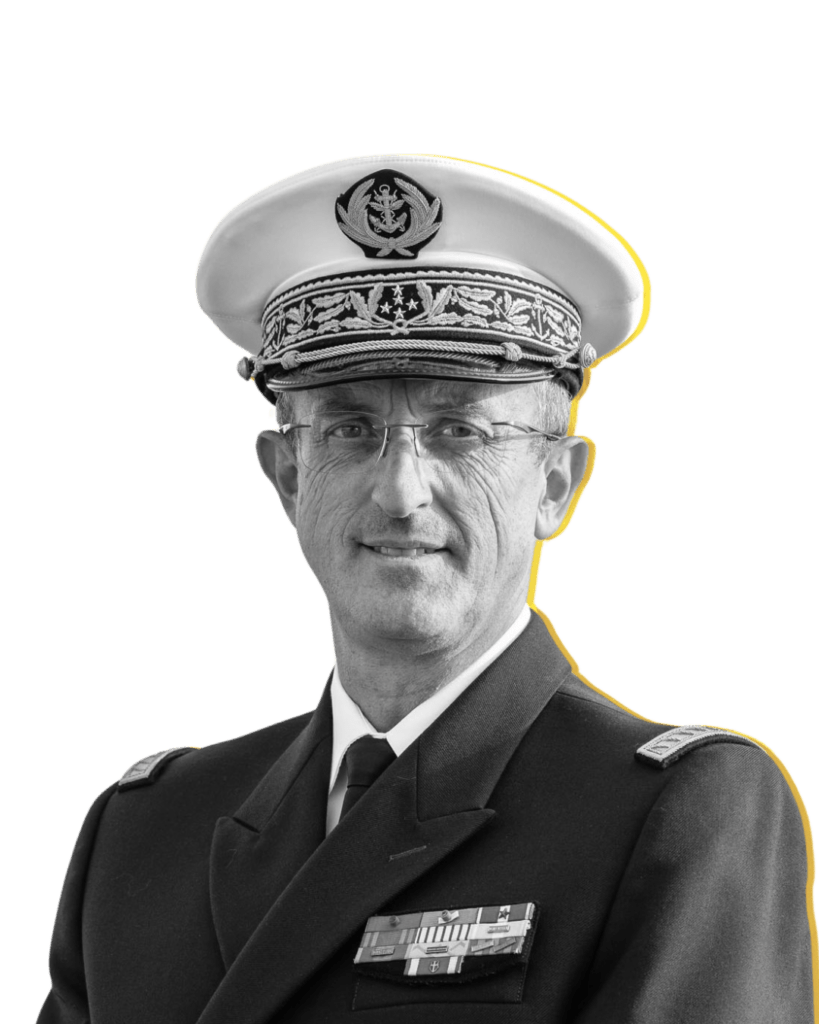Présents dans la région depuis l’Antiquité, les Kurdes ont subi une marginalisation systématique, notamment sous le régime de Bachar al-Assad. La guerre civile syrienne, débutée en 2011, a offert aux Kurdes une opportunité de s’affirmer politiquement. Le Parti de l’Union Démocratique (PYD) et sa branche armée, les Unités de Protection du Peuple (YPG), ont alors pris le contrôle de vastes zones dans le nord-est de la Syrie. Cette région, riche en ressources, est rapidement devenue un enjeu stratégique majeur, notamment face à la menace de l’État islamique (EI).
En 2014, lors de la bataille de Kobané, les YPG, soutenues par les frappes aériennes de la coalition internationale dirigée par les États-Unis, ont réussi à repousser l’EI après plusieurs mois de combats intenses. Cette victoire a marqué le début d’une collaboration étroite entre les Kurdes et les puissances occidentales dans la lutte contre le terrorisme.
| Évènements importants | Chiffres clés |
| 1920-1946 : Mandat français en Syrie : des Kurdes fuyant la répression turque s’installent dans le nord-est sous juridiction française. | 10% – Proportion de Kurdes en Syrie, soit environ 2 millions de personnes. |
| 1971 : Arrivée au pouvoir d’Hafez al-Assad et début des politiques d’arabisation et de répression des Kurdes. | Début des politiques discriminatoires contre les Kurdes sous Hafez al-Assad. |
| 2011 : Début du soulèvement contre Bachar al-Assad, le chaos permet aux Kurdes de renforcer leur autonomie dans le nord-est. | Début de la guerre civile syrienne, ouvrant une opportunité politique aux Kurdes. |
| 2016 : Opération Bouclier de l’Euphrate : la Turquie intervient militairement pour empêcher l’unification des territoires kurdes. | +3 000 – Nombre de combattants kurdes tués durant la guerre contre l’État islamique. |
| 2018 : Opération Rameau d’Olivier : la Turquie envahit Afrine, contraignant des milliers de Kurdes à l’exil. | 300 000 – Nombre de Kurdes déplacés après l’invasion turque d’Afrine. |
| Octobre 2019 : Retrait américain du nord-est syrien. La Turquie lance l’Opération Source de Paix contre les forces kurdes. | 40 km – Largeur de la zone tampon que la Turquie veut établir à la frontière avec la Syrie. |
Cependant, cette alliance s’est avérée à double tranchant. Après la défaite territoriale de l’EI en 2019, les Kurdes se sont retrouvés responsables de la gestion des prisons abritant environ 70 000 combattants de l’EI et leurs familles. Les puissances occidentales, réticentes à rapatrier ces individus, ont laissé cette lourde charge aux Kurdes, exacerbant leur isolement et leur vulnérabilité.
Parallèlement, la Turquie, voisine du nord, considère les forces kurdes syriennes comme une extension du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), qu’elle qualifie de groupe terroriste. Cette perception a conduit à des interventions militaires turques répétées dans le nord de la Syrie, visant à empêcher l’établissement d’une autonomie kurde à sa frontière.
Historiquement, les Kurdes ont souvent été utilisés comme des pions par les puissances étrangères. Sous le mandat français en Syrie (1920-1946), de nombreux Kurdes fuyant la répression turque se sont installés dans le nord-est du pays. Bien que certains aient obtenu la nationalité syrienne et aient été encouragés à s’engager dans l’armée aux côtés d’autres minorités, la montée du parti Baas et l’arrivée des Assad au pouvoir en 1971 ont entraîné des politiques discriminatoires : arabisation forcée, privation de droits fondamentaux et répression culturelle.
Malgré leur rôle décisif dans la lutte contre Daech, les Kurdes syriens n’ont jamais bénéficié d’une reconnaissance politique solide de la part de leurs alliés occidentaux. Tantôt vus comme des partenaires stratégiques, tantôt comme une gêne diplomatique face aux pressions turques, ils oscillent entre statut d’alliés et d’indésirables.
Aujourd’hui, les Kurdes de Syrie se trouvent dans une situation précaire. Leur quête d’autonomie est constamment menacée par les dynamiques régionales et internationales. Malgré leur rôle crucial dans la défaite de l’EI, ils sont confrontés à une marginalisation persistante et à des pressions externes qui entravent leurs aspirations légitimes à l’autodétermination.
Les Kurdes de Syrie ont été des acteurs clés dans la lutte contre l’État islamique, mais cette position stratégique les a également exposés à des manipulations par les puissances occidentales, qui ont souvent privilégié leurs propres intérêts géopolitiques au détriment des aspirations kurdes.
La complexité de la situation kurde en Syrie réside dans le fait que, tout en étant opprimés par le régime syrien et menacés par la Turquie, les Kurdes sont également dépendants du soutien occidental, qui peut être fluctuant et motivé par des intérêts stratégiques changeants.
En dépit des défis, les Kurdes de Syrie continuent de lutter pour préserver les droits culturels et politiques qu’ils ont acquis au cours des dernières années, cherchant à établir une gouvernance autonome qui reflète leurs aspirations nationales.
Entre Kurdes et Occident, une alliance pragmatique et asymétrique
La situation des Kurdes en Syrie illustre les tensions entre les aspirations légitimes d’un peuple à l’autodétermination et les intérêts divergents des puissances régionales et internationales, rendant leur quête d’autonomie particulièrement complexe et incertaine. Les Kurdes de Syrie, tout en étant une force majeure contre le terrorisme, se retrouvent souvent isolés sur la scène internationale, leurs alliés d’hier se montrant hésitants à soutenir pleinement leurs aspirations politiques face aux pressions régionales.
La quête d’autonomie des Kurdes syriens est entravée par une combinaison d’oppression interne, de menaces régionales et d’instrumentalisation par des puissances extérieures, mettant en péril leur avenir politique et leur stabilité. Les Kurdes de Syrie se trouvent à la croisée des chemins, leur avenir dépendant de la capacité de la communauté internationale à reconnaître et à soutenir leurs aspirations légitimes tout en naviguant dans un paysage géopolitique complexe.
La situation actuelle des Kurdes en Syrie est le résultat de décennies de marginalisation, de luttes pour l’autonomie et de manipulations par diverses puissances, rendant leur quête d’un État autonome particulièrement ardue.
Les Kurdes de Syrie, malgré leur contribution significative à la stabilité régionale, continuent de faire face à des défis majeurs en raison des dynamiques politiques internes et des influences extérieures qui entravent leur chemin vers l’autodétermination.
Si la question kurde en Syrie s’inscrit dans une histoire longue marquée par des discriminations et des conflits, elle est aussi le produit des dynamiques géopolitiques contemporaines. Le sort des Kurdes syriens est devenu un enjeu central pour les acteurs internationaux, qui, selon leurs intérêts stratégiques, les soutiennent ou les abandonnent. Cette instrumentalisation a conduit les Kurdes à jouer un rôle crucial dans la guerre contre l’État islamique, tout en les laissant dans une position d’extrême vulnérabilité face à leurs ennemis régionaux.
Le fardeau des prisons djihadistes et des camps de réfugiés
L’intervention occidentale en Syrie et en Irak après l’ascension de l’État islamique en 2014 a nécessité un acteur local capable d’opérer au sol contre les djihadistes. Les Kurdes syriens, bien organisés militairement à travers les YPG et les Forces démocratiques syriennes (FDS), ont été rapidement identifiés comme des partenaires idéaux par les États-Unis et leurs alliés.
Dans le cadre de la coalition internationale dirigée par Washington, les Kurdes ont reçu des équipements, un appui aérien et un soutien logistique. En retour, ils ont porté l’essentiel de l’effort terrestre contre l’État islamique. La victoire contre Daech en 2019 a été le point culminant de cette collaboration, mais elle a aussi marqué un tournant : une fois le califat territorialement vaincu, les puissances occidentales ont progressivement réduit leur soutien aux Kurdes.
Alors que la communauté internationale refuse de traiter la question des prisonniers de Daech, les camps sous contrôle kurde abritent des milliers de détenus radicalisés, créant une bombe à retardement sécuritaire en plein cœur du nord-est syrien.
Le revirement le plus brutal est survenu en octobre 2019, lorsque Donald Trump a annoncé le retrait des troupes américaines du nord-est de la Syrie, ouvrant la voie à une offensive militaire turque. Les Kurdes, accusés par Ankara de liens avec le PKK, se sont retrouvés exposés à une guerre asymétrique, sans le soutien explicite de leurs alliés occidentaux.
Avec la chute du dernier bastion de l’État islamique à Baghouz en mars 2019, environ 70 000 combattants et membres de familles de djihadistes ont été capturés et regroupés dans des camps sous contrôle kurde, notamment Al-Hol et Roj. Ces centres sont devenus de véritables poudrières sécuritaires et humanitaires.
La Turquie, un acteur menaçant
Les puissances occidentales, réticentes à rapatrier leurs ressortissants ayant rejoint Daech, ont largement délégué aux Kurdes la gestion de ces détenus. Or, l’administration kurde n’a ni les moyens financiers ni les ressources humaines pour assurer efficacement cette tâche. Le camp d’Al-Hol, où sont détenues environ 50 000 personnes, est régulièrement le théâtre de violences, d’évasions et de tensions sécuritaires.
En janvier 2022, une évasion massive orchestrée par Daech depuis la prison de Ghwayran à Hassaké a révélé l’ampleur du problème. Des centaines de djihadistes ont fui, obligeant les FDS à mener de vastes opérations de reconquête avec l’appui aérien américain.
Si les Kurdes ont pu asseoir leur contrôle sur le nord-est de la Syrie pendant plusieurs années, ils font face à un adversaire direct : la Turquie. Depuis 2016, Ankara a lancé plusieurs opérations militaires en territoire syrien visant à affaiblir les forces kurdes et empêcher l’émergence d’un État autonome à sa frontière.
- 2016 : Opération Bouclier de l’Euphrate → Offensive turque pour éloigner Daech mais aussi empêcher les Kurdes de relier leurs territoires.
- 2018 : Opération Rameau d’olivier → Invasion d’Afrine, enclave kurde stratégique, où la Turquie a instauré un contrôle direct avec l’appui de milices syriennes pro-turques.
- 2019 : Opération Source de Paix → Incursion visant à établir une « zone de sécurité » le long de la frontière turco-syrienne, entraînant des milliers de déplacés kurdes.
La question des Kurdes syriens
Le projet turc de réinstallation forcée de réfugiés syriens arabes dans ces territoires vise à modifier l’équilibre démographique et réduire l’influence kurde.
Ankara justifie ses actions en accusant les YPG d’être une extension du PKK, organisation considérée comme terroriste par la Turquie, mais aussi par les États-Unis et l’Union européenne. Cette assimilation empêche toute reconnaissance officielle des Kurdes syriens comme un acteur légitime sur la scène internationale.
Privés de soutien international stable, menacés militairement par la Turquie et marginalisés par le régime syrien, les Kurdes syriens se retrouvent dans une impasse politique et stratégique.
Trois scénarios se dessinent :
- Un compromis avec Damas : Pour éviter une destruction totale sous la pression turque, les Kurdes pourraient accepter un retour sous la souveraineté du régime syrien en échange d’une autonomie limitée.
- Un statu quo fragile : Les Kurdes continuent d’exercer une autonomie de facto tout en jonglant avec les alliances temporaires et la pression militaire turque.
- Une disparition progressive de l’autonomie kurde : En l’absence de soutien international et face aux assauts turcs répétés, les Kurdes perdraient progressivement leurs territoires conquis depuis 2012.
Les États-Unis, bien qu’ayant promis de maintenir un contingent militaire limité en Syrie pour sécuriser certaines zones, n’ont pas donné de garanties à long terme aux Kurdes. De leur côté, la Russie et l’Iran soutiennent Damas et se montrent peu enclins à favoriser un projet d’autonomie kurde.
Crédit image : Mohammad Bash/ShutterStock