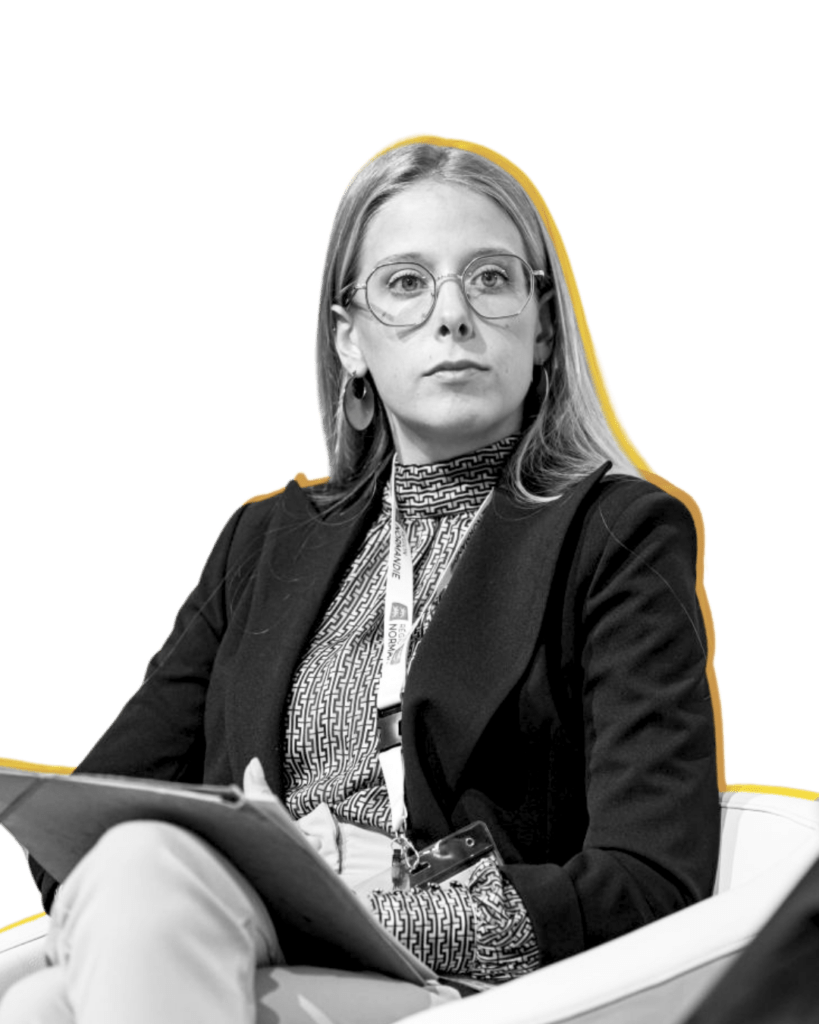Qu’entend-on exactement par autonomie stratégique européenne ?
Ce concept ne date pas d’hier. On le retrouve dès 1994 dans le Livre blanc français de la défense, où il était associé aux questions de dissuasion nucléaire. En 2013, il apparaît à nouveau dans les conclusions du Conseil européen consacrées à l’industrie de l’armement. Mais c’est surtout à partir de 2016, avec la stratégie globale de l’Union européenne, qu’il prend une dimension plus large et qu’il s’étend à d’autres domaines comme l’énergie, les communications ou l’espace. Le discours du président Macron à la Sorbonne en 2017, centré sur l’idée de puissance européenne, parachève cette évolution. Concrètement, l’autonomie stratégique consiste à réduire nos vulnérabilités et nos dépendances dans des secteurs clés. Ces dernières années, les crises successives ont mis en lumière ces fragilités. La pandémie de Covid-19 a révélé nos limites en matière sanitaire, l’évacuation de Kaboul a montré notre dépendance aux Américains pour rapatrier nos propres ressortissants, et la guerre en Ukraine souligne chaque jour notre dépendance à la Russie pour l’énergie et à la Chine pour les matières premières ou les technologies.
Pourquoi préfère-t-on parler d’autonomie stratégique plutôt que de souveraineté européenne ?
La souveraineté est d’abord un concept lié à l’État, à l’inviolabilité de ses frontières et à la maîtrise de son territoire. C’est au nom de ce principe fondamental, inscrit dans la Charte des Nations unies, que l’Union européenne soutient l’Ukraine face à l’agression russe. L’autonomie stratégique renvoie à une autre réalité : celle de souverainetés sectorielles. Lorsque l’ancienne chancelière Angela Merkel ou le président Emmanuel Macron évoquaient la souveraineté énergétique ou la souveraineté numérique, ils ne parlaient pas de frontières mais de la capacité de l’Europe à rester maîtresse de son destin dans ces secteurs stratégiques.
Peut-on imaginer une autonomie stratégique européenne compatible avec l’OTAN ?
Cette question est au cœur des tensions récurrentes entre l’Europe et les États-Unis. Chaque fois que l’on parle d’armée européenne ou même seulement de capacités de projection, Washington s’interroge sur nos intentions. Les Européens eux-mêmes restent divisés. La guerre en Ukraine a cependant clarifié les choses : l’OTAN demeure la garante de la défense collective du continent à travers l’article 5. Cela ne dispense pas l’Union européenne de renforcer ses propres capacités militaires, de gérer par elle-même l’instabilité dans son voisinage immédiat, et de se préparer à l’hypothèse où les États-Unis, absorbés par leur rivalité avec la Chine, ne pourraient pas intervenir simultanément en Europe et en Asie.
Comment distinguer la défense européenne de l’autonomie stratégique ?
Les deux notions sont intimement liées. La défense européenne vise à donner aux Européens davantage de moyens pour gagner en autonomie, sans pour autant affaiblir l’OTAN mais au contraire en renforçant son pilier européen. Lors du sommet de Versailles en mai 2022, un constat sévère a été dressé : depuis la crise financière de 2008, l’Europe a négligé sa défense. Ses dépenses militaires n’ont progressé que de 20 % en vingt ans, quand celles des États-Unis augmentaient de 60 %, celles de la Russie de 300 % et celles de la Chine de 600 %. La guerre en Ukraine rappelle l’urgence de disposer de stocks de munitions, d’artillerie, de moyens de défense antimissile ou encore de capacités de cybersécurité. Mais il faut aussi combler les faiblesses structurelles qui pèsent sur le long terme, comme le transport aérien, l’espace ou la lutte contre les menaces hybrides. Pour y répondre, l’Union européenne s’est dotée en mars 2022 de sa première « boussole stratégique », véritable livre blanc de la défense, qui fixe un agenda précis et prévoit des mesures inédites, comme l’achat commun de munitions pour l’Ukraine.
Les Européens partagent-ils la même perception des menaces ?
Les approches divergent encore. Les pays du Nord sont principalement tournés vers la Russie, tandis que ceux du Sud se préoccupent davantage du Moyen-Orient. Mais, pour la première fois, les Vingt-Sept se sont accordés sur une évaluation commune des menaces à travers la boussole stratégique adoptée en 2022. Elle repose sur trois axes : la compétition entre grandes puissances, la stabilité régionale et les menaces asymétriques. On observe par ailleurs une porosité croissante entre les crises de l’Est et celles du Sud. Wagner, par exemple, opère à la fois en Ukraine et au Sahel, tandis que la Turquie s’affirme de plus en plus dans les Balkans comme au Moyen-Orient. Progressivement, ces menaces se rejoignent pour former un arc d’insécurité commun.
Que recouvre le dilemme dit « des deux théâtres » ?
Certains analystes estiment que les États-Unis ne pourraient pas affronter deux conflits majeurs simultanément, en Asie et en Europe. Dans un tel scénario, Washington concentrerait sans doute ses moyens sur la Chine. Cela signifie que les Européens doivent envisager de pouvoir assurer eux-mêmes leur défense collective si les Américains ne sont pas en mesure de le faire.
L’autonomie stratégique concerne-t-elle uniquement la défense ?
Non, et c’est une idée reçue qu’il faut combattre. Trop souvent, l’autonomie stratégique est réduite à sa dimension militaire. Or elle englobe aussi des enjeux économiques, technologiques et industriels. Elle concerne la santé, l’énergie, le numérique, les transports ou l’espace. La Commission européenne a mis en place une boîte à outils réglementaire pour contrôler les investissements étrangers, mieux gérer les stocks, diversifier les approvisionnements et éviter les situations de monopole. Mais au-delà des règles, il est essentiel de développer des partenariats avec le secteur privé. C’est dans cette logique que l’Union a lancé, avec les industriels, des pôles d’innovation sur les batteries, les semi-conducteurs, l’hydrogène ou les médicaments, afin de ne pas laisser ces secteurs stratégiques aux mains d’autres puissances.
Dans cette perspective, faut-il repenser l’indépendance nationale ?
L’indépendance nationale demeure le socle des relations internationales : c’est la liberté d’action et de décision des États. L’autonomie stratégique européenne n’est qu’un moyen d’atteindre cet objectif. L’Union n’a pas encore tous les attributs d’une puissance globale, mais les États membres, pris isolément, n’en disposent plus non plus. C’est en agissant collectivement et en réduisant leurs dépendances qu’ils pourront préserver leur indépendance et renforcer leur liberté de choix.
Equipe: Corentin L, Gabriel C, Paul L et Elsa D