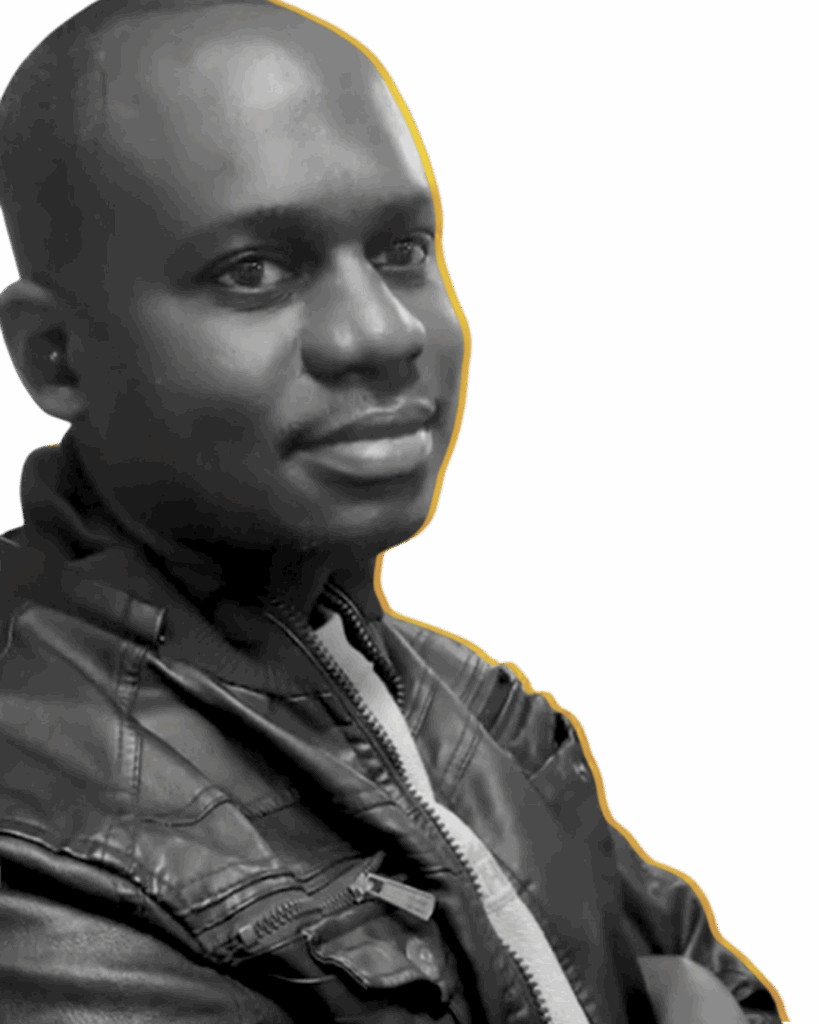I. De la parenthèse du « capitalisme démocratique » à la centralité de la dette
Un élément est décisif pour comprendre cette parenthèse : la manière dont l’État se finançait. Durant les décennies d’après-guerre, l’endettement public existe déjà, mais il ne fait pas l’objet du même type de dramatisation politique qu’aujourd’hui. La question centrale concerne alors l’inflation, la répartition capital–travail, l’extension de la protection sociale, plutôt que le « fardeau de la dette ». Cela tient en partie à la nature du dispositif de financement : la dette est largement administrée plutôt que livrée aux marchés. À travers le « circuit du Trésor », l’État français fonctionne comme une sorte d’« État banquier », pilotant la collecte et l’orientation de l’épargne nationale via un ensemble d’institutions publiques et parapubliques (Caisse des dépôts, caisses d’épargne, banques nationalisées, etc.).
Dans ce cadre, la dette publique est au cœur d’un régime d’interdépendance encadrée : l’État est un acteur central de la création monétaire, de la distribution du crédit et du financement de l’investissement. La dépendance vis-à-vis d’investisseurs privés mobiles est limitée. Le rapport de force entre capital et État social ne se joue pas encore dans le langage silencieux des taux, des spreads et des notations.
II. La mise en marché de la dette : un basculement politique
À partir des années 1970-1980, un basculement profond s’opère : l’État devient un emprunteur de marché à part entière. Concrètement, cela signifie que le financement des déficits se fait désormais par l’émission régulière de titres de dette, vendus à des banques intermédiaires puis négociés sur un marché secondaire où la dette publique devient un actif comme un autre, au même titre que les obligations d’entreprise ou les produits structurés.
Ce changement n’est pas seulement technique : il implique une reconfiguration de la souveraineté budgétaire. Là où le Trésor « faisait la loi du marché » en fixant ses propres taux et en organisant l’accès à la liquidité, il se voit progressivement soumis à la « vérité » des marchés de capitaux. Les réformes des années 1980-1990 – libéralisation financière, démantèlement progressif du circuit du Trésor, adjudications, interdiction du financement direct par la banque centrale, indépendance accrue de cette dernière – contribuent à fabriquer un État structurellement dépendant du jugement des investisseurs.
Les « road shows » organisés par le Trésor français à la fin des années 1980 illustrent de façon particulièrement parlante cette nouvelle configuration : hauts fonctionnaires et banquiers se rendent à New York, Londres ou Tokyo pour « vendre » la dette française. Dans ces tournées, la France est présentée comme un actif financier : on vante la liquidité du marché obligataire, la notation AAA, la stabilité de la monnaie… mais aussi, plus implicitement, un certain profil politique : faible inflation, acceptation de la discipline budgétaire, capacité à contenir les conflits sociaux, taux de grève modéré, etc.
La dette publique devient alors une promesse composite, qui n’agrège pas seulement des notions macroéconomiques, mais aussi des gages politiques et sociaux. L’État s’expose volontairement à un verdict continu des marchés : toute inflexion jugée « déviante » (hausse de l’inflation, dépenses sociales, réformes remises en cause) peut se traduire par une hausse des taux, une baisse de la demande de titres, ou une dégradation de notation.
III. Deux citoyennetés et une hiérarchie des promesses
L’originalité de l’approche de Benjamin Lemoine consiste à montrer que ce dispositif produit une tension entre deux formes de citoyenneté :
A. Une citoyenneté politique, territoriale, incarnée par le vote, l’appartenance nationale, la participation aux élections ;
B. Une citoyenneté de marché, déterritorialisée, exercée par les détenteurs de capitaux capables d’« arbitrer » en permanence entre les dettes souveraines : entrer, sortir, sanctionner, récompenser un pays en fonction de ses politiques.
En s’inspirant notamment des travaux de Wolfgang Streeck, Lemoine rappelle que les investisseurs peuvent « voter avec leurs pieds » : ils ne participent pas au suffrage, mais disposent d’un pouvoir de sanction immédiat, à travers les taux d’intérêt exigés et la disposition à refinancer une dette. Le jugement des créanciers tend alors à peser davantage que celui des électeurs, en particulier lorsque le financement quotidien de l’État dépend du maintien de leur confiance.
Cette asymétrie se redouble dans la distinction entre dette financière et dette sociale. Les obligations émises par l’État, détenues par des investisseurs privés, sont encadrées par un droit des contrats très robuste, assorti de mécanismes coercitifs, de clauses précises et de procédures de recouvrement bien établies. À l’inverse, les promesses sociales – retraites, santé, indemnisation du chômage, services publics – reposent largement sur des engagements politiques révisables : une réforme peut réduire des droits sans que l’on parle juridiquement de « défaut » de paiement.
Des acteurs comme les agences de notation le disent explicitement : il est plus vraisemblable, et plus « acceptable » socialement, de revenir sur des droits sociaux que de manquer un remboursement obligataire. Moody’s pouvait ainsi anticiper, dès le début des années 2000, que la plupart des pays industrialisés seraient amenés à réduire les prestations de retraite plutôt qu’à remettre en cause les obligations financières de l’État.
Cette convention sociale implicite structure une hiérarchie des promesses : les créances financières bénéficient d’une protection juridique et politique supérieure à celle des créances sociales.
IV. Une redistribution à l’envers : classes épargnantes et classes débitrices
La conférence met ensuite en évidence les effets distributifs de ce régime d’endettement. Dans un contexte où l’État emprunte massivement sur les marchés, la question n’est plus seulement « combien doit-on ? », mais aussi « à qui devons-nous ? ». Les données citées par Lemoine montrent un écart marqué entre les classes sociales en matière d’épargne : en France, les 20 % les plus modestes ont un taux d’épargne négatif, tandis que les 20 % les plus aisés disposent d’une capacité d’épargne très largement positive.
Autrement dit, nous ne sommes pas tous « détenteurs de la dette » au même titre. Ceux qui possèdent des actifs financiers – directement ou via des produits d’épargne, des fonds, des assurances vie – sont, pour partie, les créanciers de l’État. Ceux qui n’en possèdent pas dépendent principalement de l’État social et des services publics. Dans ce cadre, la combinaison de politiques fiscales favorables au capital (baisse des impôts sur les plus riches, flat tax, allègement de l’imposition du capital) et de recours intensif à l’endettement peut aboutir à une redistribution à rebours : baisse d’impôts pour les plus dotés, qui disposent ensuite d’une épargne abondante à placer en dette publique rémunérée.
La notion de bondholding class, forgée dès la fin du XIXᵉ siècle par Henry Carter Adams, permet de qualifier cette fraction sociale spécifique : une classe de détenteurs d’obligations d’État, minoritaire numériquement mais disposant d’un poids économique et politique disproportionné. Des travaux plus récents montrent que, dans certains pays, le 1 % le plus riche détient plus de la moitié de la dette publique entre les mains du secteur privé. L’État devient alors l’objet d’un double rapport : pour une partie de la population, il est surtout la source de services collectifs et de transferts sociaux ; pour une autre, il est aussi un débiteur qui assure le rendement de portefeuilles patrimoniaux.
V. La dette comme contrainte politique : le laboratoire grec
Le cas grec occupe une place centrale dans la démonstration de Benjamin Lemoine, comme laboratoire extrême de la gouvernementalité par la dette. À partir de la réévaluation brutale du déficit public en 2009, la Grèce voit les taux d’intérêt exigés pour son refinancement s’envoler, les spreads avec l’Allemagne se creuser de manière spectaculaire, et la possibilité d’emprunter sur les marchés se refermer rapidement.
Face à cette situation, l’intervention ne vient pas seulement des marchés, mais aussi des créanciers officiels regroupés dans la « troïka » (Commission européenne, BCE, FMI). Les plans d’aide sont accordés en échange de programmes d’austérité très stricts et de réformes structurelles, intégrant des conditionnalités détaillées. Lorsque le Premier ministre Georgios Papandréou, en 2011, envisage de soumettre ces conditions à référendum, la menace de suspension des versements entraîne l’abandon du vote et sa démission. Quelques années plus tard, en 2015, le gouvernement Syriza organise un nouveau référendum, qui voit la victoire du « non » aux exigences de la troïka ; mais, confronté à la perspective d’un asphyxie financière, il finit par accepter un nouveau plan dans des termes très proches de ceux initialement contestés.
Ce double épisode illustre, selon Lemoine, la collision entre souveraineté démocratique et souveraineté des créanciers. Les citoyens peuvent bien voter, protester, tenter de renverser l’ordre des priorités entre dette sociale et dette financière ; dès lors que l’accès au financement dépend d’un petit nombre d’institutions et d’investisseurs, le résultat du scrutin ne suffit plus à fonder la marge de manœuvre. Le pouvoir de dire « non » se déplace en grande partie des urnes vers les marchés et les instances financières.
Dans ce cadre, la Banque centrale européenne joue un rôle ambigu. D’un côté, elle intervient comme stabilisateur en dernier ressort, notamment à travers des programmes d’achat massif de dette souveraine sur le marché secondaire (quantitative easing) et la promesse de faire « tout ce qu’il faut » pour préserver l’euro. De l’autre, elle conditionne ces interventions à des trajectoires budgétaires jugées « soutenables » et veille à ne pas neutraliser totalement la fonction disciplinaire des marchés. La frontière entre stabilisation monétaire et pressions politiques devient alors poreuse.
VI. Un capitalisme « discipliné par la dette » : quels enjeux pour la démocratie ?
En conclusion, Benjamin Lemoine insiste sur le fait que la dette ne peut plus être appréhendée comme un simple accident de parcours budgétaire, ni comme une fatalité purement comptable. Elle constitue désormais un levier structurant de l’ordre politique :
a. en hiérarchisant les promesses (préférence systématique pour le respect des contrats financiers sur la préservation des droits sociaux) ;
b. en reconfigurant les lignes de fracture sociales (entre classes épargnantes et classes dépendantes des services publics) ;
c. en déplaçant le centre de gravité de la souveraineté (du couple gouvernement–Parlement vers les marchés et les institutions financières).
Ce diagnostic conduit à interroger la formule même de « capitalisme démocratique » : dans la mesure où le financement de l’État est de plus en plus subordonné à l’approbation de créanciers volatils, dotés d’un pouvoir de sortie permanent, la capacité des citoyens à orienter réellement les politiques publiques par le vote se trouve réduite. Les grandes options budgétaires – niveau de dépense sociale, fiscalité sur le capital, organisation de la protection sociale – sont encadrées par des contraintes qui se présentent comme « techniques », mais qui traduisent des choix de hiérarchisation entre intérêts.
Pour autant, la conférence ne se limite pas à un constat pessimiste. En rappelant l’existence historique d’autres modes de financement – comme le circuit du Trésor ou les formes d’« État banquier » –, Lemoine suggère que la situation actuelle n’a rien de naturel ni d’inévitable. D’autres architectures institutionnelles sont concevables, dans lesquelles le financement de l’État serait moins dépendant des marchés financiers mondialisés, et davantage arrimé à des logiques de délibération démocratique et de planification collective.
L’enjeu ultime rejoint le fil rouge du cycle DEMOS : penser à nouveau frais l’avenir démocratique dans un monde en crise, en prenant au sérieux la matérialité des instruments qui organisent le pouvoir. La dette n’est pas seulement une colonne de chiffres dans un rapport ministériel ; elle est un langage politique, une technologie de gouvernement et un champ de luttes. C’est à ce titre qu’elle constitue un observatoire privilégié pour comprendre ce que deviennent, aujourd’hui, la souveraineté populaire et la promesse d’égalité dans les démocraties capitalistes.